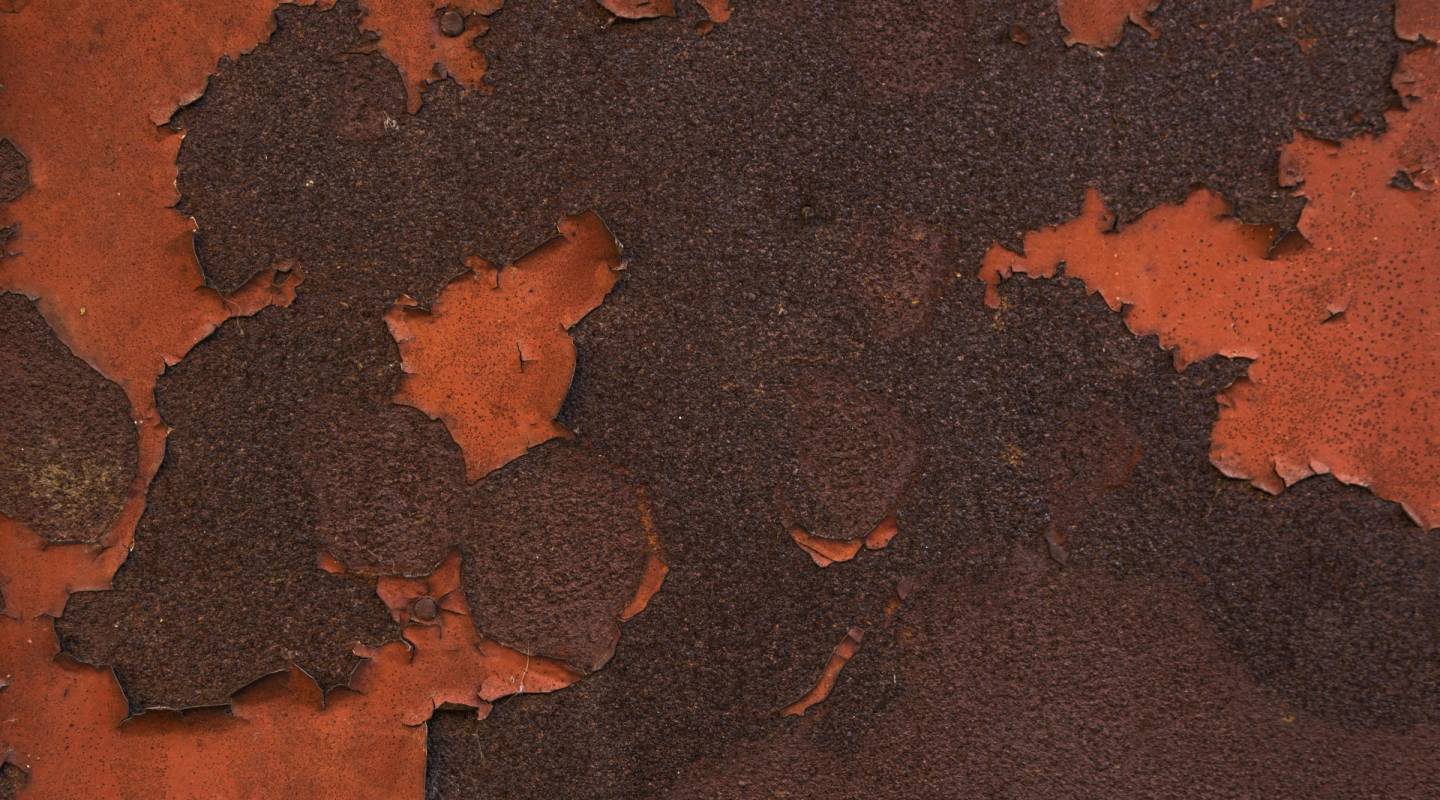LISVDHE. Au Nord-Kivu, il y a huit prisons centrales et de nombreux cachots, un pour chaque poste de police, sans compter ceux des services de renseignements militaires.
Lorsque nous nous rendons en prison, nous avons plusieurs objectifs. Le premier consiste à vérifier la régularité de l’arrestation. La personne a-t-elle été appréhendée sur mandat d’arrêt, sur convocation ? La procédure a-t-elle été respectée ? Nous essayons, dans le contexte actuel de guerre, de lutter contre les disparitions forcées : une personne peut être arrêtée et être ensuite introuvable, alors que nous pensions qu’elle se trouvait en prison. Nous recevons parfois des familles qui nous disent qu’elles n’ont pas vu leur proche depuis longtemps. Nous devons alors faire le tour des prisons pour voir si la personne se trouve dans l’une d’elles.
Nous vérifions ensuite le respect des droits des personnes détenues et des préalables du procès équitable. Les personnes ont-elles accès à un.e juge compétent.e pour leur affaire ? Le délai est-il raisonnable ? Sont-elles soumises à des actes de torture ? La personne a-t-elle déjà été entendue ? Certaines personnes passent une année en détention sans comparaître devant un.e juge. Notre aide légale vérifie, dans ce cas, qui est le ou la magistrat.e instructeur.rice et pourquoi la personne n’a jamais été entendue. Nous essayons alors d’obtenir sa libération dans l’attente de son procès.
Le nombre de magistrat.es est vraiment limité. Il n’est pas rare qu’une personne gère 200 ou 300 dossiers, ce qui affecte évidemment l’exécution des décisions.
Nous prêtons également attention à l’alimentation des personnes détenues. La loi prévoit trois repas par jour mais, en réalité, elles ne mangent qu’une fois - et encore, c’est par grâce qu’elles trouvent à manger. Elles s’endorment parfois affamées. Beaucoup comptent sur leurs proches pour amener de la nourriture mais qu’en est-il des personnes qui ont été arrêtées à 50 km de chez elles et dont les familles n’ont pas les moyens de leur rendre visite ? Pour elles, la situation est particulièrement difficile.
Nous engageons, en parallèle, un travail de plaidoyer auprès des juges, des avocat.es et des autorités du pays. Nous demandons que les choses changent. Ce n’est pas possible que les gens souffrent autant. Même si ces personnes ont violé la loi, il faut les aider. Nous menons des campagnes de sensibilisation aux droits des personnes incarcérées. Nous distribuons nos dépliants à tout le monde, même aux officier.es de la police. Nous disposons des affiches à côté de l’entrée des prisons. Il y a cinq ans, le procureur avait, grâce à notre plaidoyer, exigé que chaque personne qui arrive en détention reçoive un papier sur lequel ses droits sont mentionnés. Il faut que chacun.e connaisse ses droits pour pouvoir les revendiquer, parce nous ne sommes pas présent.es à chaque instant. Nous mettons des avocat.es à disposition des personnes détenues, via trois cliniques juridiques gratuites rattachées à notre organisation. Ce service d’aide s’adresse aux personnes qui n’ont pas d’avocat.e et qui sont sans ressources financières.